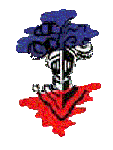

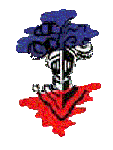

Depuis l'annexion de l'Autriche (printemps 1938), la tension internationale n'avait cessé de s'accroître et
de peser d'un poids sans cesse plus lourd sur les esprits, les relations économiques et les affaires en général.
Je me souviens de la première mobilisation, en 1938, et de l'émotion qui régnait alors à Compiègne, écoute
passionnée à la radio, ruée vers les avis d'appel de certaines catégories de réservistes, afflux de clients à
l'Etude venant retirer des fonds ou des titres ou prendre d'ultimes dispositions de famille, sanglots des femmes
, etc...
Malgré ce spectacle, mon optimisme naturel, bien que soumis à une rude épreuve, me permit de conserver mon
sang-froid, au moins pendant cette première alerte grave. Nous avons passé ainsi, avec des alternatives diverses
, la période Septembre 1938 Septembre 1939, jusqu'au moment critique de la tension germano-polonaise (3
Septembre 1939).
Le 3, dans la matinée, l'annonce à la T.S.F. de l'entrée des Allemands à Dantzig et un coup de téléphone
d'André Bondu, prévoyant les plus graves événements d'une heure à l'autre, nous déterminent, Ginette et moi, à
évacuer dans l'après-midi, à Conon, les valeurs au porteur des clients, les testaments et donations, ainsi que
mes papiers personnels et l'essentiel de notre argenterie et de notre linge fin. Voyage sans incident, par Meaux
et Fontainebleau, parmi un afflux de voitures évacuant Paris et transportant les objets les plus hétéroclites.
A Blois, je loue, non sans peine, un compartiment de coffre à la Caisse d'Epargne et nous convenons, avec mon
père, qu'il en conservera la clef et fera parvenir à monsieur Marigny, nommé suppléant de l'Etude, les valeurs
et pièces dont il aurait éventuellement besoin.
Je quittai Conon le 4 au soir, après avoir embrassé les miens, Dieu sait avec quel serrement de cœur et, ayant
laissé Ginette, les enfants et la voiture, je regagnai Compiègne, où j'arrivai seulement dans le courant de la
nuit.
Le5, (première alerte d'aviation vers 1 heure du matin), après avoir arrêté avec monsieur Marigny les diverses
mesures nécessaires à la bonne marche de l'Etude, dans les circonstances du moment, je pris le train pour
Orléans, où m'appelait mon ordre de mobilisation. Je me suis présenté, aussitôt arrivé, au quartier Rossat où
j'ai appris mon affectation au 64° G.R.D.I. (Groupe de Reconnaissance Divisionnaire d'Infanterie), en formation
avec des réserves du 8e Chasseur, et je fus versé à l'escadron de fusiliers-motocyclistes, en
qualité de maréchal des logis, faisant fonction de maréchal des logis chef.
Le groupe s'est constitué à Saran, à quelques kilomètres d'Orléans, et se composait de quatre escadrons
(Fusiliers-motocyclistes, escadron à cheval, escadron de mitrailleuses, escadron hors rang), d'un effectif
total d'environ 650 hommes, sous le commandement du Lieutenant Colonel Mallet.
Mon escadron était sous les ordres du Capitaine Libert, propriétaire agriculteur dans le Morvan, homme d'un
caractère assez froid et autoritaire de prime abord, mais avec qui je suis parvenu peu à peu à maintenir de
cordiales et même d'affectueuses relations. .Cet officier fut rappelé à l'arrière en avril 1940.
Parmi les quatre lieutenants, je citerai particulièrement Monchicourt, gendre du colonel André Charoy, excellent
garçon et l'un des officiers que j'ai connu ayant pris son métier le plus à cœur. D'après les renseignements
que je possède, au moment où j'écris ces lignes, Monchicourt aurait été tué dans l'Aube, le 14 Juin 1940, en
cherchant à s'échapper de l'étau dans lequel le groupe fut fait prisonnier.
Je nommerai encore Plotton, négociant à Pithiviers, qui prit le commandement de l'escadron au départ du
Capitaine Libert et avec qui je fis tout la partie active de la campagne (mai-juin 1940).
A l'exception de mon vieux camarade de Toulgoët, gentleman farmer, adjudant de l'Escadron, puis nommé aspirant,
et auquel je devais succéder dans ses premières fonctions, je ne retrouvai aucun compagnon du 8e
chasseur, ce qui m'a toujours semblé assez inexplicable. Mon pauvre ami aurait partagé, je crois, le sort du
lieutenant Monchicourt, lors de la fatale journée du 14 Juin. Parmi les sous-officiers, je citerai Rouillé,
charmant garçon, plein de fantaisie, qui nous quitta malheureusement en janvier, en raison de son état de santé
, et Benois, mon camarade peut-être le plus affectionné, chargé du dépannage, petit garagiste à Bourges, d'une
humeur et d'un caractère toujours égaux en toutes circonstances, malgré les soucis de toute sorte qui
l'assaillaient.
Enfin, Salvy, notre benjamin, petit-fils de Pierre de Nolhac, libraire à Versailles, garçon séduisant, lettré,
avec qui j'entretins, au cours de la campagne et surtout en captivité, un commerce du meilleur aloi.
Quant aux hommes, pour la plupart des cultivateurs du Centre, je n'eus aucunement à me plaindre de mes
relations avec eux et j'estime qu'ils firent tous leur devoir (esprit de corps de la cavalerie !) pendant les
tragiques événements auxquels nous fûmes mêlés, avec une discipline et un courage dignes d'un meilleur sort.
Le 64e G.R.D.I., définitivement constitué le 15 Septembre 1939, ainsi qu'en fait foi son procès-
verbal de formation, était l'élément de cavalerie de la 55° Division d'Infanterie (Général Britsch, puis
Général Lafontaine) composée, par ailleurs, des 295e , 313e et 331e régiments
d'infanterie et du 45e régiment d'artillerie.
Le même jour, nous primes la route vers l'Est. Je conduisais la voiture Peugeot 202 qui m'était affectée, où
je pris place avec mon secrétaire, et où se trouvaient logées les archives de l'escadron, ainsi que mes armes
et affaires personnelles.
J'ai utilisé cette voiture d'un bout à l'autre de la campagne, jusqu'au jour où je fus fait prisonnier et elle
se comporta, en toutes circonstances, à la hauteur des efforts qui lui furent demandés (grâce aux soins de mon
ami Benois et de son équipe).
Après deux longues étapes (Orléans-Sens et Sens-Chalons sur Marne), accomplies avec un certain désordre et sans
méthode apparente, les convois automobiles ne cessant de se dépasser et de se couper les uns les autres, nous
avons cantonné trois jours à Dannevoux (Meuse), où nous fûmes bien reçus par la population et bien logés, et
deux jours à Samogneux, ancien village complètement détruit au cours de l'autre guerre, où nous fûmes beaucoup
moins bien.
Le 22 Septembre, nous arrivons à Ville-devant-Chaumont, dans l'ancienne zone rouge, où nous devions rester trois
semaines et où nous nous installons d'une manière satisfaisante.
Les autres éléments de la 55e D.I. établissent leur cantonnement dans les villages avoisinants
(Damvillers, Flabas, Dun-sur-Meuse). La Division étant unité indépendante, se trouvait ainsi en position
derrière Verdun en "réserve générale d'armée".
Mon travail m'intéressait, surtout la mise au point complète de la comptabilité de l'Escadron. J'eus l'occasion
de faire de fréquentes promenades à cheval, notamment la liaison avec les autres escadrons, en raison de la
pénurie d'essence, et de parcourir ce pays hallucinant où la végétation n'a pu reprendre que partiellement
depuis l'autre guerre. C'est avec une grande émotion que je visitai les lieux historiques et terribles où se
déroula la Bataille de Verdun (Bois des Caures et de Ville, fort de Douaumont, tranchée des Baïonnettes).
Le 19 Octobre, la 55e D.I. reçut l'ordre inopiné de se déplacer et d'occuper le secteur Nord-Est
de Sedan, pour en organiser la défense. Ce mouvement fut exécuté sous une pluie battante et nous arrivâmes à
Donchery sur Meuse le 21, après étape à Germont. Le Groupe traversa la Meuse, alors débordée, pour s'installer
à Saint Menges à six kilomètres de la frontière belge, où nous devions rester jusqu'à la date fatidique du 10
Mai 1940.
Je conserverai un souvenir ému de mon long séjour dans cette localité d'ouvriers et de l'accueil affable de ses
habitants. Je logeais avec mon camarade Benois chez Madame Labbé, modeste ouvrière de tissage et je ne peux
dire les petits soins dont cette excellente femme nous combla (il est vrai que les cartes lui avaient prédit
qu'elle ferait la connaissance d'un "homme de loi", et qu'il en résulterait beaucoup de bonheur pour elle !).
Nous couchions à deux dans le propre lit de son fils, mobilisé, elle faisait notre chambre, préparait notre
petit déjeuner et souvent le dîner, lavait et entretenait notre linge.
Le soir, nous nous réunissions avec d'autres camarades, dans sa cuisine, où il y avait un bon feu, et nous y
passions d'agréables soirées, agrémentées de parties de manille et de belotte.
J'étais assez libre de mon temps et bénéficiais d'une grande latitude dans la conduite de mon travail. Nous
allions quelquefois passer le dimanche à Sedan, applaudir la troupe du théâtre aux armées et d'excellents
musiciens, comme Cortot.
L'hiver vint nous trouver à, Saint Menges, avec un très grand froid et une neige abondante et je souffris
assez cruellement d'un commencement de pied gelé.
Deux permissions de détente, que je passai à Paris, Conon, Compiègne, me retrempèrent dans le milieu de ma vie
normale.
Aux beaux jours, je travaillais au jardin de ma logeuse, parcourais les prairies voisines, à la recherche des
pissenlits, ou simplement en poussant ma canne, je contemplais le beau pays des Ardennes, agréablement vallonné,
et coupais ainsi l'écoulement des longues heures monotones, bien éloigné des miens et de mes affaires,
celles-ci pourtant bien gérées par l'excellent monsieur Marigny.
Le travail du Groupe se réduisait à effectuer quelques patrouilles avec les gardes frontaliers et les douaniers
et à établir des abris et des emplacements de défense autour du village, besogne qui n'aurait pas du être
réservée à des cavaliers, bien que le 64e ait eu justement à combattre dans les positions qu'il
avait lui-même créées (Positions de la Bécasse et du Cimetière de Saint Menges). Le temps aurait pu, il me
semble, être plus utilement employé à l'entraînement au travail spécifique des groupes de reconnaissance.
Le 64e était alors détaché de sa division d'infanterie. Il constituait avec le 12e Groupe
de Reconnaissance de Corps d'Armée, le "Groupement de Bouillon", dont la mission révisée était de couvrir un
secteur d'environ 6 kilomètres, en avant de la 2e armée, (Général Hutzinger). En cas d'attaque
ennemie par la Belgique, nous devions nous porter sur la Semoy, sans la dépasser, prendre le contact et nous
replier sur la ligne fortifiée de la Meuse, en opérant une "action retardatrice" devant l'offensive adverse.
De temps en temps, nous recevions la visite d'avions allemands, mis en fuite et quelquefois abattus par notre
D.C.A. et notre aviation de chasse.
Nous avons également subi plusieurs alerte de départ, toutes en pleine nuit (notamment lors de l'invasion de
la Norvège) dont l'une au cours de laquelle le Groupe occupa la ligne de défense organisée par le Génie
immédiatement le long de la frontière belge et jalonnée par des ouvrages et des maisons-fortes.
Le 10 Mai 1940, date historique, nous sommes réveillés vers 5 heures du matin par la canonnade de la D.C.A.
tirant dans un ciel d'azur sur un certain nombre d'avions ennemis volant à grande altitude. Mais ce n'est que
vers 7 heures que nous apprenons la nouvelle de l'invasion de la Hollande, de la Belgique et du Luxembourg. Le
Groupe s'était déjà spontanément formé et attendait les ordres.
Le Groupement de Bouillon était alors dissous. Nous étions toujours détachés de la 55e D.I. et
faisions partie de la 5e Division légère de cavalerie (Général Chanoine) comprenant : le 11e
cuirassiers, le 15e chasseurs, le 2e spahis algériens, enfin le 12e groupe de
reconnaissance de corps d'armée et le 64e G.R.D.I. formant brigade sous le commandement du Général
Brown de Colstoun, toutes unités cantonnées au nord-est de Sedan, auxquelles devaient s'adjoindre des autos-
mitrailleuses et des éléments de génie. La mission de la 5e D.L.C. était de pénétrer en Belgique,
de prendre contact et de "pousser en avant". Le plan de l'Etat-Major avait donc été changé (les conséquences
devaient en être graves). Il ne s'agissait p1us de se cantonner sur la position défensive de la Meuse, après
reconnaissance sur la Semoy, mais, au contraire, d'exécuter un raid de cavalerie de grande envergure, précédant
vraisemblablement une contre-offensive de la 2e Armée sur Namur.
Les 3 escadrons de combat (motos, cheval, mitrailleuses) et le groupe de commandement du Colonel se mettent en
route vers 8 heures du matin et seuls restent à Saint Menges le Train de combat et le Train régimentaire, qui
ne devaient rejoindre la colonne que le soir. Quant à moi, je commandais les éléments de T.C. et de T.R. de
mon escadron (voitures à munitions et à vivres, cuisine roulante, voiture de ravitaillement, camion-essence et
camion-magasin).
Toute la journée s'écoule dans une attente fiévreuse, militaires et civils se pressant autour des postes de
radio pour entendre les nouvelles émises d'heure en heure, et nous assistons au passage incessant de troupes
de la division gagnant la Belgique. Enfin, vers 18 heures, les Trains s'ébranlent à leur tour, nous franchissons
bientôt la frontière, traversons la Semoy à Aile, dans un site charmant des pittoresques Ardennes belges,
ainsi que les villages de Mogimont et Rochehaut, les bois sont parsemés de tracts lancés par les avions
allemands, invitant les soldats wallons à la fraternisation.
Partout, accueil empressé de la population (café, cigares, jambon etc...). Au carrefour du Menu Chenet, je suis
chargé d'opérer la liaison avec des éléments de gardes-forestiers belges. Enfin, nous arrivons à Paliseul,
vers 21 heures, et nous cantonnons dans nos voitures.
Le lendemain 11 Mai, dès les premières heures du jour, nous assistons au reflux incessant des réfugiés belges
se dirigeant vers la frontière française. Nous apprenons que le contact est pris à Libin par nos escadrons avec
des patrouilles ennemies. Des avions allemands nous survolent mais semblent nous ignorer. Cependant, peu à peu,
les nouvelles s'aggravent, l'ennemi semble progresser et nous assistons au repli successif d'éléments de
chasseurs ardennais et de lanciers belges, enfin à l'évacuation de Paliseul par les autorités civiles et les
gendarmes.
Les camions du génie de notre division traversent également la ville, retournant vers la frontière et les
avions allemands se font de plus en plus nombreux, sans qu'il soit possible d'apercevoir un seul avion français.
Enfin, à 18 heures, nos escadrons de combat se replient à leur tour et nous nous joignons à eux, après avoir
détruit les appareils de télégraphe et de téléphone du bureau de poste. Le repli s'effectue sans encombre,
malgré les perturbations causées par les cortèges nombreux de réfugiés. Je remarque, se repliant par une route
parallèle à la nôtre, le 2e spahis, quelque peu en désordre et ayant visiblement souffert (nombre
de chevaux sans cavalier). Nous nous attendions à prendre position dans la forêt d'Ardennes, et, au moins, à
rencontrer des forces françaises importantes, venant de France et que nous devions, vraisemblablement, avoir
précédées la veille, mais, à notre grande surprise, nous ne voyons personne et les premières troupes que nous
rencontrons sont à Alle, un bataillon du 295e R.I., venu protéger notre repli derrière la Semoy et
assurer la destruction, par le génie, du pont d'Alle et l'explosion des mines placées le long de la frontière.
Le groupe traverse la Semoy, dans le sens opposé à celui de la veille, vers 20 heures, les Trains s'immobilisent
sur la route de Saint Menges et les escadrons de combat s'installent le long de la rivière, établissant leurs
armes automatiques dans les roseaux, cependant que le bataillon du 295e R.I. retraverse à son tour
la rivière et s'établit à côté de nos escadrons.
Bientôt le pont d'Alle saute avec fracas et nous entendons à peu près sans interruption l'explosion de mines
placées à tous les points stratégiques.
Les autres éléments de la 5e D.L.C. ont franchi la rivière, de leur côté, sans encombre et viennent
s'installer à notre gauche et à notre droite.
Vers 22 heures seulement, les avant-gardes allemandes, constituées par des engins blindés et des motocyclistes,
qui n'avancent qu'avec une certaine circonspection et en menant grand tapage, arrivent au niveau de la Semoy,
et engagent aussitôt l'action, avec force armes automatiques et emploi de balles lumineuses, dites traçantes.
Pour moi, je reste avec les Trains, sur la route, écoutant la fusillade et l'explosion des mines et suivant le
tir de l'artillerie du Hattoy, dont les coups de départ illuminaient l'horizon.
12 Mai - Au petit jour, le 64e commence l'opération de décrochage de sa position, pour occuper la
ligne des Maisons-fortes, position intermédiaire entre Alle et Saint Menges (blockhaus de béton, défendus par
quelques hommes armés d'un mortier de 60 et de fusils-mitrailleurs).
Nous sommes bien heureux de revoir nos camarades dont le moral est bon, malgré quelques pertes sensibles.
(Le bataillon du 295e ne devait pas participer à ce mouvement, j'ignore pour quelle raison ; il ne
disposait, il est vrai, que des jambes de ses hommes, tandis que nous nous déplacions beaucoup plus rapidement.
Ce bataillon subit de fortes pertes, tant en tués et blessés qu'en prisonniers. J'assistai néanmoins au repli
de ses groupes cyclistes. De son côté le 12e G.R. C.A. perdit aussi pas mal de monde, surtout en
officiers.
Les Trains se replient les premiers et nous arrivons à Saint Menges vers 5 heures du matin. Le village avait
été évacué par ses habitants la veille, dans l'après-midi. Nous y restons environ 2 heures. Je m'occupe de
faire placer dans un camion le maximum d'armes et de sacs de permissionnaires de notre groupe qui étaient
restés entreposés près de l'Eglise, tout en laissant, faute de place, beaucoup d'effets d'équipement et une
quantité de selles et de sabres qui se trouvaient là, je ne sais par quel hasard, et je fis une dernière visite
à la pauvre maison de Madame Labbé, qui devait, hélas, bien souffrir du bombardement, quelques heures plus
tard.
L'aviation ennemie était très active, mais nous pouvons enfin apercevoir des avions français et assister à
plusieurs combats aériens.
Malgré l'intervention des officiers et des sous-officiers, j'eu le regret d'assister à un certain nombre de
scènes de pillages de magasins. Par ailleurs, c'était un massacre général des poules et des lapins du pays,
qui, il est vrai, seraient tombés autrement entre les mains de l'ennemi.
Enfin, nous quittons Saint Menges, traversons Floing et arrivons à Sedan, où nous ne trouvons que peu de troupes
, toujours à notre grande surprise. Aucune impression de la concentration massive d'hommes et d'engins de feu
que nous nous attendions à voir le long de la Meuse.
Nous traversons la rivière au pont de Torcy, à peu près seuls dans la nature, pour gagner ensuite Chéhéry et
enfin la Cassine, petit château situé dans les bois, où devait se regrouper le 64e, et alors occupé
par un régiment de pionniers, très émus et déjà en désarroi. Peu après, se joignent à nous un détachement
d'environ 200 cavaliers du 11e Cuirassiers. J'apprends que c'est tout ce qui reste du régiment qui
faisait partie, comme nous, de la 5e D.L.C. et que le surplus a été dispersé du côté de Bouillon
par les autos-mitrailleuses ennemies.
A ce moment, nous pensions bien que la ligne de défense de la Meuse (malgré notre fâcheuse impression) allait
opposer le barrage pour lequel elle avait été crée à l'avance allemande, et que le rôle actif du 64e
était momentanément terminé.
Eh fait, le 64e était alors détaché de la 5e D.L.C. et réintégré dans la 55e
D.I., qui occupait la ligne fortifiée de la Meuse devant nous, à côté de la 71e D.I. Ces deux
divisions, qui dépendaient de la 2e Armée (Général Hutzinger) formaient charnière avec l'armée
voisine (général Corap). L'attaque allemande sur Sedan devait justement avoir lieu sur cette charnière (armée
du Général Guderian) et les 55e et 71° D.I., formées de réservistes relativement âgés, porteront
dans l'Histoire le triste privilège d'avoir laissé percer la "ligne Maginot prolongée".
Dans l'après-midi, nous recevons quelques torpilles aériennes, qui tuent plusieurs pionniers et nous obligent
à quitter le château de la Cassine pour nous établir dans les bois du même nom.
Pendant ce temps, les escadrons de combat avaient poursuivi leur action retardatrice et combattu sur leurs
positions de défense successives aménagées entre la Semoy et la Meuse, c'est-à-dire ligne des Maisons-fortes,
Saint Menges et Floing. Finalement, ils traversent la Meuse pendant la nuit et viennent s'établir, aux premières
heures de la matinée du 13, dans les bois de la Cassine, à quelques centaines de mètres de nos positions.
La nuit est calme, nous entendons à maintes reprises, comme au cours d'autres nuits, le chant du rossignol.
Il est possible que ce fût le signe de ralliement de parachutistes allemands, ainsi qu'on l'a dit depuis.
Le 13, nous subissons toute la journée le bombardement de l'aviation ennemie, par vagues successives de 20 à
30 appareils, bien entendu sans aucune intervention d'avions français et en dépit de la réaction d'une D.C.A.
généralement inopérante. Il nous faut pratiquer des trous individuels, souvent bouleversés par l'explosion des
bombes et la chute des branches d'arbres.
Nous déplorons la mort d'un certain nombre de nos camarades, notamment de plusieurs téléphonistes et
secrétaires du Colonel, écrasés sous les décombres d'un pavillon où était logé le P.C. et assistons au
massacre d'une partie des chevaux de l'escadron à cheval.
Je profite d'une accalmie pour porter moi-même en voiture le ravitaillement et le courrier (bien arriéré) des
escadrons de combat. Inutile de dire que je ne muse pas en chemin, la route étant visée par l'aviation ennemie.
Je trouve mes camarades très fatigués et déprimés par les durs combats qu'ils avaient menés sans interruption
depuis 48 heures, et notamment le Lieutenant Plotton, commandant l'escadron motos, en proie à une véritable
crise nerveuse.
C'est avec émotion que je constate la disparition de bien des nôtres. Le matériel avait, d'autre part, beaucoup
souffert et une grande partie des motos avait du être abandonnée (on constitua des groupes de fusiliers-portés).
De retour à mon emplacement, j'essaie d'organiser mon bureau d'escadron auprès de ma voiture et de travailler
à la préparation des dossiers des camarades tués ou disparus, dont j'avais relevé les noms, mais les alertes
incessantes d'aviation rendent bientôt toute besogne impossible.
Vers 18 heures, nous constatons que les réfugiés passent en flots de plus en plus nombreux, qui ne tardent pas
à être suivis par des pionniers et des travailleurs espagnols, puis apparaissent des attelages d'artillerie et
des voitures auto et hippomobiles. Le bruit insensé court que les Allemands ont franchi la Meuse ! A 20 heures
le flot de fuyards est très dense et ne constitue pas un spectacle réconfortant à contempler. Nous ne pouvons,
à notre tour, que nous y joindre, en essayant d'y apporter un minimum d'organisation.
Vers 23 heures, nous arrivons au Chesne Populeux, où l'on parvient à peu près à se regrouper. Je reçois l'ordre
de faire dégager la route pour laisser passer un contingent de chars moyens français (les premiers que nous
ayons vu depuis le début des opérations), qui arrivent de Reims pour contre-attaquer sur la Meuse. Etant
descendu de voiture, je causais avec un officier d'infanterie et avec un officier de ce régiment de chars.
Ayant échangé des cigarettes, je craquai une allumette pour offrir du feu à mes deux interlocuteurs et je me
préparais à allumer ma cigarette, mais l'officier de chars souffla l'allumette en disant "L'instant est trop
grave pour tenter le sort, l'un de nous trois peut en pâtir". J'ignore ce qu'il est devenu, mais je sais que
les chars allaient presque tous être détruits dans la journée du lendemain. Quelques heures après défilent
aussi des chars de gros tonnage qui devaient faire besogne plus heureuse.
14 Mai - Au petit jour, nous arrivons à Toges, le long d'une prairie bordée de pommiers et longée par un
ruisseau abrité sous des peupliers. Nous y cantonnons. Le lieu est absolument découvert, mais nous n'avons,
paraît-il, pas le choix de nous installer ailleurs, Nous pouvons enfin nous laver et nous reposer un peu. Vers
16 heures, nous subissons une violente attaque d'avions ennemis, qui n'avaient eu, évidemment, aucun mal à
repérer notre convoi. Ils sont pris à partie par des avions Curtiss et je vois encore les acrobaties de tous
ces avions, se croisant et se survolant en tous sens, "autour de la lune". L'effet était extraordinaire.
Soudain, les avions allemands descendent en piqué, en faisant siffler leurs sirènes et nous bombardent de
torpilles accompagnées de rafales de mitrailleuse. Tout le monde s'égaille dans la prairie, cherchant un abri
précaire sous les pommiers ou le long du ruisseau.
Je vécus là les plus mauvais moments de toute la campagne. Je m'allonge sous un pommier, le nez dans un sillon,
sentant mon cœur battre à coups précipités, en entendant le sifflement des torpilles en l'air et en sursautant
à chaque déflagration. Pour ma part, je suis encadré par deux torpilles qui éclatent à quelques mètres de moi
et creusent dans le sol de profonds entonnoirs, et je vois les balles de mitrailleuse faire voler la terre
tout autour de mon pommier. C'est en ces moments que le moins croyant fait un acte de foi et s'en remet
entièrement à la volonté de Dieu.
Par un hasard miraculeux, personne n'est atteint. Un officier et quelques hommes seulement sont commotionnés.
Des camions, par contre, ont été traversés par des balles et une voiture a été pulvérisée.
15 Mai - Le soir même, à minuit, les Trains continuent leur repli et viennent s'installer au matin dans les
bois de Longwé, après avoir longé Vouziers en flammes, à quelques kilomètres de Grandpré, et nous y restons
cantonnés 7 jours, du 15 au 21, rejoints bientôt par nos escadrons. Nous y avons passé des heures de répit,
que j'emploie, pour ma part, à mettre au point ma comptabilité passablement en retard.
Nous nous trouvons au Sud de la fameuse "poche de Sedan", où le front se stabilise quelques jours, grâce
notamment à l'emploi judicieux des escadrons de cavalerie, qui interviennent comme bouche-trou lors de la
défaillance d'un régiment d'infanterie et qui contiennent sur ce point l'avance allemande (combat du Mont Dieu).
Notre bois, où se trouvait installée une batterie de D.C.A., fut cependant bombardé par les avions ennemis, qui
encadrèrent cette batterie par des chapelets de bombes. Là aussi, j'éprouvai une grande émotion et, blotti
dans un entonnoir d'obus datant de l'autre guerre, je passai de pénibles moments, les yeux fixés sur la photo
de ma petite famille et sur les images religieuses que je portais toujours sur moi. L'impression est terrible
d'entendre les bombes se rapprocher de seconde en seconde et le cœur se serre en songeant que la 3e,
la 2e, la prochaine...
Nous allions faire notre toilette dans un petit ruisseau qui servait aussi d'abreuvoir aux chevaux, nous
dissimulant sous les arbres pour ne pas être aperçus du "mouchard" ennemi qui ne cessait de survoler le bois.
Le 21, à minuit, tout le 64e quitte le bois de Longwé, afin de gagner un cantonnement où nous devions
recevoir des renforts, ainsi que des armes, des effets et du matériel dont nous avions le plus grand besoin.
Une première étape nous conduit au Fort du Rozelier, près de Verdun, où nous devons nous installer, faute de
place, dans les casemates, sur les glacis et ce, malgré une pluie battante (la première depuis le 10 Mai). De
là, pour faire la place à d'autres corps de troupes, venant aussi se reformer, nous cantonnons dans le bois
d'Amblonville (22 et 23 Mai) et enfin dans ceux de Rupt en Woëvre, où nous arrivons le 24 et où nous restons
jusqu'au 5 Juin.
Cette période permet au groupe de se reconstituer. Nous recevons notamment des renforts venus du dépôt de
cavalerie de Vesoul, presque tous Alsaciens. Nous mettons là un semblant de vie de cantonnement de repos. Le
soir, j'allais avec quelques camarades chez une brave femme de Rupt, où nous avions installé une sorte de
popote. Une messe solennelle fut célébrée avec beaucoup d'émotion, à la mémoire de nos morts, par l'Abbé
Villin, aumônier du 64e. Au cours d'une prise d'armes eut lieu la remise des Croix de Guerre et
récompenses méritées par le Groupes la majeure partie échut à mon escadron. Pour ma part, je fus promu au
grade d'adjudant, en remplacement de mon camarade de Toulgoët, nommé lui-même aspirant. D'après l'ordre de
nomination, c'était pour "les gros services rendus à l'escadron" (surtout, je crois, pour le travail
d'organisation fourni précédemment). Mais, pour le moment, je devais continuer à assumer mes fonctions
antérieures jusqu'au jour où j'aurais pu former un successeur (comptabilité et commandement des Trains de
l'escadron).
La 55e D.I., fort éprouvée, est alors reformée sur de nouvelles bases Elle devient la 71e
division légère et fut réduite à un seul régiment d'infanterie, le 135e, composé des débris des
295e, 313e et 331e, un régiment d'artillerie, le 45e, et un
G.R.D.I., le nôtre, qui prit le numéro 47.
Le 5 Juin, à 19 heures, nous recevons un ordre de départ inopiné pour une destination inconnue et nous roulons
toute pour arriver le lendemain à Fleury sur Aire (Meuse) où nous ne restons qu'une journée.
Le 7, nous partons dans la direction de Vitry le François, se fait sentir la poussée ennemi et nous cantonnons
à Villers le Sec. C'est là où je devais recevoir les dernières nouvelles de ma famille jusqu'au 20 Septembre.
En route, nous rencontrons une foule de permissionnaires rentrant, de toutes unités, pauvre troupeau désemparé,
ballotté de village en village depuis plusieurs jours, sans aucune organisation. Dans la masse, nous repêchons
quelques-uns de nos hommes, trouvés là par hasard, qui se joignent à nous avec des transports de joie.
Le 8, nous sommes à Heiltz le Maurupt, avec mission d'en organiser la défense, mais à peine le Colonel a-t-il
commencé à ses dispositions que nous recevons un nouvel ordre gagner Sainte Menehould, menacée par l'ennemi.
Cette série d'ordres et de contre-ordres nous donne, hélas, l'impression que l'Etat-Major est dépassé par les
événements. Nouvelle route de nuit et arrivée le 9 à Sainte-Menehould, fort éprouvée par les bombardements.
Les escadrons de combat commencent à en organiser la défense. Quant aux Trains, ils cantonnent à la Grange aux
Bois, à quelques kilomètres de la ville, dans un coin ombragé et riant, où la guerre et ses tristesses
paraissent bien éloignées, et où je déjeune d'œufs frais et de laitage.
Le 10, nous percevons dans le lointain une canonnade littéralement ininterrompue, en direction de Vouziers.
Il s'agissait, je crois, d'une contre-offensive française de ce côté. Le lendemain, nous rejoignons les
escadrons à Sainte-Menehould, dont l'évacuation a lieu le même jour par la population. C'est là gue nous
apprenons l'entrée en guerre de l'Italie et ce geste de lâcheté, joint aux spectacles peu réconfortants que
nous avions vus depuis le 10 Mai, fait tomber le moral bien bas. J'essaie cependant de réagir et j'organise
une baignade générale dans l'Aisne, afin de profiter du temps idéal dont nous étions gratifiés (Hitlerwetter,
décidément !).
Le 11 Juin, nouvel ordre impromptu d'"embarquer" avec toute la division, pour la frontière italienne,
croyons-nous. En fait, seul l'escadron à cheval prend le train à la gare de Sainte Menehould et le reste du
groupe s'achemine une nouvelle fois par la route, vers 14 heures, emportant quantité de volailles et lapins
laissés sur place par les habitants, mais la plupart devaient mourir étouffés et furent gâchés.
Le soir même, nous logeons au Châtelier, village occupé par des pionniers qui venaient de recevoir, le même
jour, des..., fusils gras, dont ils ignoraient le maniement et qui avaient établi des barricades de fortune
aux issues du pays, vraiment dérisoires contre les panzers.
Le 12, nous quittons Le Châtelier, de bonne heure, pour une longue étape. Nous traversons successivement
Vitry-le-François et Arcis sur Aube et nous apprenons, en cours de route, que notre division venait de recevoir
soudainement l'ordre de boucher le trou formé par le recul d'une division, près de Sézanne.
Arrivée dans cette ville, vers 16 heures, dans une confusion terrible. Nous essayons de nous frayer un passage
parmi les convois de civils qui cherchaient à fuir et les troupes qui refluaient. Celles-ci nous apprennent
que, malgré les pertes qu'elles avaient occasionnées à l'ennemi (tirs d'artillerie et d'armes automatiques
ouvert, à 150 mètres sur l'infanterie allemande s'avançant au coude à coude) elles avaient dû reculer devant
le nombre, abandonnant une grande partie de leur matériel.
De fait, nous croisons nombre d'avant-trains d'artillerie sans pièce et des éléments épars d'infanterie à
travers champs dans le plus complet désarroi, avec beaucoup de blessés ; puis, peu à peu, plus personne. La
route est vide et l'ennemi va apparaître. Impression violente !...
Vers 20 heures, nous occupons nos positions dans le bois de Gault, garni d'une grande quantité de caisses de
munitions et d'obus, que le train des équipages essayait d'enlever. Nous appréhendons un bombardement parmi
toutes ces caisses éparses. La nuit est toutefois fort calme et la canonnade ne commence que vers 5 heures du
matin, mais sans violence exagérée.
13 Juin. Cependant, vers 8 heures, nous remarquons des infiltrations de fantassins du 135e R.I.
(de notre division), qui refluent en désordre à travers le bois. Le lieutenant Parouty de notre groupe tente
de s'y opposer et je viens lui prêter main forte, en ma qualité d'adjudant. Je suis heureux, en ce qui me
concerne, d'arrêter une centaine de fuyards sans trop de difficultés.
Ces hommes me déclarent qu'ils ont du céder devant l'attaque des chars ennemis, qu'ils n'ont plus de munitions,
qu'ils ont le ventre vide depuis la veille et que leurs officiers leur auraient dit de f... le camp !!... Je
fais ouvrir aussitôt des caisses de cartouches et des sacs de biscuits, et j'organise un ravitaillement en
munitions et en vivres. Puis, je fais appeler les sous-officiers et parviens à reformer quelques sections,
que je renvoie en avant.
Je dois signaler spécialement l'attitude de deux sergents polonais d'un groupe autonome de pièces anti-chars,
qui se présentent à moi de la manière la plus correcte et me remettent des lunettes télémétriques qu'ils
avaient pu sauver, me demandant de les prendre dans ma voiture, après en avoir exigé un reçu, ce que je fais
aussitôt. Bel exemple de sang-froid et de conscience professionnelle !...
Mais, malgré tous nos efforts, l'afflux des fuyards devint bientôt torrent et un commencement de panique gagne
nos hommes, qui mettent les voitures en marche pour quitter le bois. N'ayant pas reçu d'ordres et devant
l'absence d'officiers, je prends le parti de commencer l'évacuation, en évitant un trop grand désordre.
Nous nous replions ainsi de quelques kilomètres, derrière le village du Mesnil, où les Trains se rejoignent
vers midi, à l'abri d'un bois, et nous pouvons enfin manger une soupe chaude (ce que nous n'avions pas fait
depuis deux jours). Des vagues successives d'avions italiens viennent toutefois nous survoler, mais ne nous
prennent pas à parti, malgré la belle cible que constituaient les chevaux haut-le-pied de l'Escadron à cheval,
traversant au grand galop la plaine qui nous sépare du Mesnil. Par contre, l'aviation s'acharne sur le
malheureux village qui est bientôt en flammes.
A 14 heures arrive un nouvel ordre de repli. Le capitaine commandant les Trains me donne l'ordre d'attendre
certains éléments d'arrière-garde, encore en arrière, pour leur indiquer le nouveau lieu de concentration
(village de Connantre), mais je ne peux remplir ma mission car l'ennemi arrive (nous n'avons plus eu aucune
nouvelle de ces éléments retardataires).
Je me hâte de reprendre ma voiture qui s'enlise d'abord dans la boue, et je me replie à mon tour par une route
visée et bombardée par l'aviation. A un moment, je suis obligé de m'arrêter et de chercher un abri dans le
fossé. A côté de moi se trouve un fusilier-mitrailleur isolé, qui combat avec beaucoup de courage et réussit à
abattre un avion volant en rase-mottes. De malheureux civils courent çà et là, affolés et me supplient de les
prendre avec moi, ce qui m'est, hélas, impossible.
Finalement, après avoir longé un terrain d'aviation jonché de carcasses d'avions détruits au sol, je retrouve
tout le groupe dans le village de Connantre, dont la défense était confiée à quelques chars et à des éléments
d'infanterie embusqués dans les fossés de la route et les maisons, Nous n'y faisons d'ailleurs qu'une courte
halte et nous reprenons la route, cette fois toute la nuit, nous dirigeant je crois, vers Paris. Nous sommes
harassés, rien n'est plus déprimant que de conduire toute une nuit, sans lumière, dans la cohue !
14 Juin - Au petit jour, nous atteignons Méry sur Seine. Cette petite ville venait d'être bombardée et la
chaussée était jonchée des décombres des maisons et de cadavres de chevaux. Le pont était intact, mais la
présence d'un énorme entonnoir à moins de cinq mètres prouvait qu'il avait échappé de bien peu à la destruction.
L'affluence des troupes et des voitures et le cortège des réfugiés étaient tels que nous ne pûmes franchir la
Seine qu'avec plusieurs heures de retard, ce qui devait être, paraît-il, l'une des causes de notre capture.
Vers midi, le groupe quitte la route qu'il suivait péniblement et fait halte au village de Saint Loup de
Buffigny, lieu de concentration de la division. Hélas, nous sommes seuls ! Ce retard nouveau devait nous être
fatal.
Au moment de repartir, nous entendons des coups de feu au sud de la localité : ce sont les avant-gardes
allemandes. Aussitôt, nous essayons de sortir du village par le nord, et deux pelotons protègent la retraite,
avec des éléments de l'escadron de mitrailleuses. Je dois dire que cet élément, jugeant la résistance
impossible, met bas les armes.
Nous faisons quelques centaines de mètres, jusqu'au hameau du Ferreux, qui se trouvait déjà occupé par
l'ennemi. Ma voiture suit celle du Colonel, qui stoppe brusquement devant la menace de plusieurs motocyclistes
allemands, armés de mitraillettes. Le Colonel descend, suivi de son officier adjoint, et se rend. Quant à moi,
je sors inutilement mon révolver, mais devant les injonctions impératives des soldats allemands, je dois le
jeter et lever les mains en l'air. Les cavaliers se mettent en fourrageurs, parviennent pour la plupart à
gagner des bois et s'éclipsent. Presque tout le groupe est ainsi capturé, sauf quelques isolés comme les
lieutenants Parouty et Monchicourt et l'aspirant de Toulgoët, avec plusieurs hommes, qui tentent de s'échapper
et dont nous ne devions plus avoir de nouvelles.
Quant à nous, nous devons nous ranger sur le bord du chemin, abandonnant toutes nos affaires militaires et
personnelles (je n'avais absolument que ma tenue et mon bonnet de police, et ne pus emporter ni manteau ni
effets chauds, ni objets de toilettes). Les armes sont mises en tas et les voitures sont laissées aux mains de
l'ennemi. Enfin, nous lui montrons les corps de trois camarades tués, qui avaient été placés dans un fourgon
et on nous promet de les enterrer, après leur avoir rendu les honneurs militaires.
Nos vainqueurs nous forment en colonne et nous conduisent, en nous pressant sans cesse, jusqu'à un carrefour
où nous sommes séparés de nos officiers. Je ne peux m'empêcher de pleurer de honte et de chagrin.
Grâce aux quelques éléments de langue allemande dont je me souviens, je sers d'interprète pour transmettre les
ordres qui nous sont donnés. Je dois dire que nous sommes traités d'une manière courtoise par nos ennemis, qui
appartiennent à une panzerdivision et nous sommes frappés par leur jeunesse et la conviction de leur foi en les
destinées de leur patrie. Ils se proclament nos amis et nous donnent force cigarettes. (Du moins eux, les
combattants, paraissent souhaiter de bonne foi, pour l'avenir, un sincère rapprochement franco-allemand.
Combien différente devait être la mentalité de leurs dirigeants quand il fut question de nous libérer et
quelles belles occasions ils ont laissé passer de travailler ainsi utilement à ce rapprochement !).
Bientôt nous sommes survolés par une escadrille française (enfin, mais hélas trop tard !). Elle est
dangereusement encadrée par la D.C.A. allemande (la Flak) et laisse tomber quelques bombes sur un village
proche. Le soir même, nous sommes acheminés sur Nogent sur Seine, où nous sommes parqués à plus de 10.000 dans
la Halle et sur la place du Marché, et où nous devons rester jusqu'au 16 Juin, sans ravitaillement. Nous y
commençons à souffrir de cette faim qui nous tenailla au cours des semaines à venir. Il était également
impossible de se mouvoir, et même de se coucher, en raison de l'énorme affluence d'hommes sur un si petit
espace.
Le 16, nous commençons la longue série d'étapes que nous devions fournir jusqu'au 21 (Nogent sur Seine-Esternay
- Esternay-Montmirail - Montmirail-Soissons - Soissons-Laon - Laon-Guise - Guise -Catillon). Journées très
pénibles en raison de la chaleur (il est vrai que la pluie eut été pire !), de l'absence quasi totale de
nourriture, sauf quelques biscuits de guerre et ce que nous pouvions dérober dans les champs, et de la longueur
exagérée des étapes (jusqu'à 50 kilomètres par jour avec, au maximum, trois haltes de chacune dix minutes.)
Je me souviens des ruées autour des quelques fontaines que nous rencontrions sur notre chemin, afin de remplir
un quart ou un bidon, brutalement interrompues par les coups de crosse de nos gardiens, déjà très différents
des soldats qui nous avaient capturés, et même par les coups de feu qu'ils tiraient au sol à tout moment.
Beaucoup de prisonniers, notamment des officiers âgés, furent incapables d'aller jusqu'au bout et durent être
emmenés en fourragères. Quelques autres même succombèrent et il nous fallut les laisser au bord du chemin,
enveloppés dans des couvertures.
Pour ma part, je supportai passablement ces épreuves et pus même soutenir pendant de longues heures mon pauvre
camarade Benois, très affaibli.
Nous avons traversé des villes terriblement endommagées, comme Villenauxe, Montmirail, Château-Thierry, et des
lieux où le combat avait dû être violent à en juger par le nombre de tombes fraîches creusées au bord de la
route, la quantité de cadavres de chevaux en décomposition remplissant les fossés et celle d'engins de toute
sorte jonchant le terrain : chars et canons détruits, monceaux d'équipement abandonnés et par le bouleversement
du sol labouré par les entonnoirs de bombes et d'obus.
Le 24, nous sommes embarqués à Ors, près de Cambrai, dans des wagons de marchandises et tassés à raison de
soixante par wagon. Nous sommes acheminés, à travers la Wallonie, jusqu'à Trèves, où nous séjournons dans un
camp, le 26 et le 27 et où nous pouvons enfin prendre un peu de repos et apaiser notre faim.
Le 27, au soir, nous reprenons le train dans les mêmes conditions. Nous traversons l'Allemagne, par Coblence,
Marbourg, Gotha, Weimar et Leipzig et finalement nous arrivons à Sagan (Basse Silésie) le 29, à 5 heures du
matin.
Le camp, aménagé à quelques kilomètres de la ville, pour environ 60.000 prisonniers, sur un terrain sablonneux,
planté ça et là de maigres bouleaux, est adossé à une forêt de sapins rachitiques. Il comprend toute une série
de baraques, construites en briques, divisées en blocs, séparés les uns des autres par des treillages en fil de
fer barbelé. Le long de la forêt se trouve le camp extérieur constitué par des rangées de tentes, où je devais
tout d'abord rester un mois. Je fus désigné comme chef de tente et eus à m'occuper d'environ 300 hommes,
subdivisés en groupe de 18, tant au point de vue discipline, qu'au point de vue ravitaillement, corvées etc...
Fin juillet, je passai dans le camp proprement dit, où je devais rester jusqu'aux premiers jours de janvier
1943, après avoir changé, à maintes reprises, de baraques et de blocs.
J'ai noté ici simplement mes propres impressions et celles que j'ai recueillies auprès de mes camarades
prisonniers, ayant appartenu à d'autres unités. Je n'avais alors ni la possibilité de m'entretenir avec des
personnes qualifiées possédant une vue d'ensemble de la situation, ni celle de me former une opinion par la
lecture des journaux et documents de toute sorte.
Je crois, tout d'abord, que la longue immobilité de l'hiver 1939 n'a pas été utilisée, comme il eut été
souhaitable, au parachèvement de l'instruction militaire des troupes, non plus qu'au renforcement de notre
ligne de défense.
Les Allemands avaient imaginé une tactique offensive absolument nouvelle, consistant en une attaque massive
par engins blindés, lancés droit devant eux et traversant la ligne de résistance adverse, sans se préoccuper
de leur ravitaillement en carburant et munitions, ni de leur liaison avec le gros de leurs forces. Les blindés
devaient ensuite s'emparer des ponts et nœuds de jonction en arrière de la ligne de résistance et cueillir les
troupes ennemis refluant en désordre.
Cette tactique avait cependant été employée en Pologne avec un plein succès et il est étonnant que nos troupes
n'aient pu être familiarisées ni avec ce genre d'attaque, ni avec la parade défensive appropriée. Or, dans mon
groupe, il a été fait une seule conférence en janvier 1940 sur ce sujet aux officiers et sous-officiers, et ce
n'est qu'au début de Juin (donc avec trois semaines de retard) qu'il a paru une circulaire dans les corps de
troupes prescrivant la constitution de séries de centres de résistance immobiles "hérissés" de feux de tous
côtés et devant laisser passer les engins ennemis dans leurs intervalles (vieilles tactiques déjà employée
cependant par les Romains contre l'assaut des éléphants carthaginois !).
Il semble aussi qu'une erreur stratégique capitale ait été commise en lançant nos divisions blindées en avant
de la position fortifiée, alors que les Allemands avaient déjà forcé la ligne de résistance belge et occupé
des positions leur permettant de s'opposer victorieusement à notre avance, puis de poursuivre l'encerclement
ou la destruction de leurs adversaires ainsi dangereusement engagés.
N'eut-il pas été préférable d'attendre l'ennemi de pied ferme et avec toutes nos forces sur la ligne Maginot
et son prolongement ? D'ailleurs, il semble que tous les efforts n'aient pas été faits pour assurer
l'inviolabilité de notre ligne de défense et justement dans la région de Sedan-Charleville où eut lieu la
rupture, route cependant séculaire des invasions allemandes où trop de blockhaus étaient inachevés et où
l'artillerie et l'infanterie ne disposaient que d'une réserve insuffisante de munitions.
Comment, d'autre part, l'Etat-Major n'a-t-il pu faire fermer sur l'assaillant les deux lèvres nord et sud de
la trouée qu'il avait pratiquée dans la région de Laon-Saint Quentin. Il est possible, il est vrai, que le
recul des forces anglaises sur Arras ait créé un tel hiatus que cette opération, d'abord envisagée, soit
devenue, dès lors, impossible à réaliser. Enfin, l'aviation française semble avoir presque partout brillé par
son absence ! On a prétendu que le 9 mai un ordre mystérieux aurait été donné aux principales bases aériennes
de sortie des appareils sur le terrain et que, cet ordre ayant été exécuté, une grande quantité d'avions
aurait été ainsi détruite au sol par l'aviation allemande, le lendemain.
Au point de vue moral, et malgré de très belles actions locales, nos soldats, surtout les jeunes, ont manqué,
il faut bien le dire, d'esprit combatif et d'esprit de sacrifice. La guerre était, certes, assez peu populaire
et l'inaction des mois d'hiver avait engourdi les hommes, mais que dire de ces jeunes en qui l'idée de Patrie
n'existait pas et qui ne songeaient qu'à "se tirer" égoïstement dans les fossés des routes ou sous-bois
(comme j'en ai vu tant), laissant ainsi "en l'air" et sans liaison leurs camarades des unités voisines !.
Quelles responsabilité ont encourue les dirigeants français et les instituteurs qui ont délibérément tué dans
l'esprit des générations récentes la foi, aussi bien religieuse que nationale, qu'ils auraient du, tout au
contraire, exalter en eux !
Quelle différence aussi avec la jeunesse des troupes de choc allemandes, brûlante de patriotisme et de
confiance en leur doctrine nationale-socialiste et se lançant en avant, souvent avec la plus folle témérité!
Ce sera, je crois, l'une des tâches les plus urgentes que nous aurons à accomplir pour restaurer notre
malheureux pays, que de détruire le mal ainsi propagé chez nous par nos politiciens criminels et de réformer
complètement l'éducation des futures générations, en la basant sur nos vieux idéaux nationaux et toujours
vrais : Foi, Famille et Patrie !..
La nourriture était totalement insuffisante : café d'orge le matin et le soir, soupe à 11 heures, de pommes de
terre (au début, avec leurs épluchures), de rutabaga, d'orge ou de morue, et casse-croûte à 16 heures, composé
d'un pain de guerre allemand pour 5, et d'une petite quantité de graisse assez suspecte, de fromage, de
poisson, de margarine ou de saucisson.
Peu à peu, tous mes camarades furent dispersés dans des commandos de travail, auxquels j'échappai en ma qualité
d'adjudant.
Les journées s'écoulaient, monotones, partagées entre les marches en colonnes dans les cours, les appels et
les distributions de vivres.
Les baraques étaient très humides et froides et nous couchions sur des planches sans paille, avec un nombre
restreint de couvertures, et en proie aux attaques virulentes des parasites dont nous ne pouvions parvenir à
nous débarrasser, malgré de fréquents passages à l'étuve qui réduisait nos effets en lambeaux.
Je ne reçus des nouvelles des miens, de l'Etude et de ma maison, que vers le 15 Septembre et je laisse à penser
combien j'en souffris, ignorant absolument ce que les uns et les autres étaient devenus dans la tourmente. Par
la suite, cependant, lettres et colis vinrent jusqu'à moi, bien peu nombreux, et très irrégulièrement.
C'est dans cette situation que je trouvai mon réconfort en Dieu et en moi-même. Un foyer ardent de vie
spirituelle se forma bientôt dans l'une des baraques transformée en chapelle, décoré avec un goût pieux par de
nombreux artistes prisonniers. J'y assistai avec admiration aux offices émouvants célébrés matin et soir devant
une assistance chrétienne et édifiante au possible, avec des affluences de milliers de fidèles et chorale et
orchestre de 50 exécutants aux grandes fêtes.
Je veux en conclure que le sentiment religieux n'est qu'endormi au cœur de bien des Français et qu'il suffit
d'une grande épreuve collective pour le faire refleurir plus vivace que jamais. Puisse ce réveil ne pas être
un feu de paille et puissent nos compatriotes mesurer enfin la profondeur de l'abîme moral et religieux où les
ont entraînés les mauvais bergers qui les ont si longtemps dirigés !...
Et la vie s'organisa peu à peu, encore que, pour ma part, je n'eusse jamais voulu "m'installer" et que, malgré
de périodiques déceptions, je vécus dans l'attente d'une prochaine libération.
Le désarroi des esprits était complet. Ainsi que je l'écris plus haut, la grande majorité cherchait un refuge
et une consolation dans la religion et, à un autre point de vue, l'on s'interrogeait sur l'avenir de la France.
La République et la Démocratie étaient communément tenues pour responsables de nos malheurs. L'idée d'autorité
faisait du chemin dans les esprits et tout naturellement celle de la Royauté était accueillie par beaucoup
comme la solution possible.
Aussi quand nous apprîmes que le glorieux Maréchal Pétain prenait en mains les destinées du Pays, une immense
espérance fit vibrer les cœurs.
Pétain a été pour les prisonniers, pendant de nombreux mois, le symbole de tout ce qui nous était cher et que
nous avions laissé là-bas.
Les premières mesures adoptées ont soulevé un prodigieux intérêt et une adhésion quasi-unanime.
Je garderai le souvenir le plus émouvant de la fête du 1er mai, nouveau jour national. Le drapeau
français était hissé à un mât, devant les prisonniers fixés au garde à vous. Une messe solennelle était dite
en plein air, l'autel était décoré de francisques tricolores et l'appel auguste à Dieu, à la fin de l'Office,
était devenu dans son loyalisme religieux et national : "Domine, salvum fac ducem nostrum, Philippum !..."
L'aumônier général des prisonniers, l'Abbé Rodhain, contribua d'ailleurs, par son éloquence, à susciter
l'affection au Maréchal, en disant notamment, en chaire : "Le Maréchal est la clef de voûte sur laquelle tout
repose. S'il s'écroule, tout est perdu." Des formules de serment de fidélité ne tardaient pas à se couvrir de
signatures par milliers.
Les "journées du Maréchal" réunissaient les "chefs d'œuvres" des artisans de tous les corps de métiers et des
conférences publiques informaient un chacun des réformes du nouveau gouvernement.
Pour ma part, je fus chargé d'exposer l'œuvre législative au point de vue constitutionnel et administratif.
Les "Cercles de la Révolution Nationale" réunirent l'élite sociale et intellectuelle du camp et étudièrent,
d'une manière approfondie, les initiatives et les réalisations dans tous les domaines.
Je dois dire que l'un des mouvements les plus populaires fut celui de la reviviscence des provinces françaises.
L'on se groupait pour échanger des nouvelles de sa ville et de son terroir, pour assister tel ou tel compatriote
peu favorisé en lettres et en colis ; on portait avec fierté l'écusson de sa province et des expositions
régionales étaient organisées, à grand renfort de vues photographiques, maquettes de monuments, cartes
touristiques etc...
Mais, si le programme de politique intérieure était accepté par tous les prisonniers de bonne foi et de bonne
volonté, il n'en était pas de même des questions de politique étrangère (les idées alors émises étaient-elles
en avance sur leur temps ?) et des discussions parfois pénibles laissaient des esprits dans le désarroi et
l'incertitude.
Ayant toujours craint le désœuvrement, j'essayais d'employer mon temps de la manière la moins inutile possible.
Au cours de bien des promenades solitaires, de profondes méditations sur mon passé et l'organisation future
de ma vie me procurèrent des aperçus nouveaux et déterminèrent en moi des réflexions philosophiques dont
l'effet bienfaisant continue encore à inspirer les actes de mon existence.
Le matin, par le beau temps, je faisais un peu de gymnastique ou j'arpentais le terrain de sport pendant de
longues heures.
J'ai toujours éprouvé une impression de froid en ce triste pays, malgré quelques semaines torrides en été où
l'on se mettait à peu près nu, sans doute en raison de notre nourriture insuffisante (heureusement corrigée
par les colis impatiemment attendus et les "vivres Pétain").
Pendant plusieurs jours, j'ai travaillé à la "Lagergeldkasse", puis au service des abonnements, aux journaux
de France, et à leur distribution ; mais ma principale occupation a consisté à organiser l'Université du camp,
avec le concours de professeurs et de prêtres. Je m'étais réservé la partie juridique et je fis des causeries
de droit pratique. D'ailleurs, je donnais journellement des avis à bien des camarades sur leurs affaires,
notamment sur beaucoup de perspectives de divorces, hélas.
Je fis aussi des causeries mélancoliques et passionnées sur mes chères contrées de Compiègne et du Blaisois et
les résumai dans le journal du camp "Le Soleil Saganais". Ma meilleure récompense fut le mot d'un de mes
auditeurs "Avec Blois et Compiègne, vous avez résumé toute l'Histoire de France"...
En pensant à Ginette, j'appris quelques rudiments d'italien et j'y goûtai bien des joies philologiques.
Je lus beaucoup et écrivis bien des notes de réflexions et de commentaires sur ce que m'avaient inspiré mes
lectures.
Le théâtre et les concerts eurent aussi sur moi une influence apaisante.
Enfin, je suivis quelques cours d'allemand complémentaire et m'intéressai à. la Principauté de Sagan, d'origine
française. Je traduisis des ouvrages évoquant le Prince de Talleyrand et la "Belle Dorothée", duchesse de Dino.
Des facilités me furent d'ailleurs accordées pour visiter la ville et le parc du château.
Quelle joie, lors de ma première sortie, après un an de séjour au camp, de voir enfin des civils et des
magasins.
J'eus aussi l'occasion de faire quelques promenades dans la campagne environnante, où les paysans nous
voyaient d'un bon œil et où ma barbe me faisait appeler "Gross'vater" par les enfants.
Les rapports avec les autorités allemandes étaient corrects. Le Commandant du camp, le Major von Vallenberg
était un de ces européens humanistes et cultivés, capables de conversations d'intérêt général, en dehors de
toute politique.
Les derniers mois de ma captivité, je m'intéressai, d'ailleurs, au Mouvement "Jeune Europe" persuadé que
l'avenir de notre civilisation est dans l'entente et l'harmonie des nations de notre continent, sans y apporter
les outrances racistes.
Fin décembre 1942, alors que je m'étais allongé sur mon sac de couchage, je suis informé à l'improviste par un
journal de l'Oise que m'apporte un camarade, du retour décidé des prisonnier compiégnois (en remerciement,
paraît-il, du bon accueil réservé par les habitants de la ville aux rapatriés d'Allemagne) et j'apprends
quelques jours après que je fais partie du premier contingent prévu.
Départ du camp, dans les premiers jours de janvier 1943, laissant, non sans quelque émotion, de bons camarades,
qui se raidissent pour dissimuler un peu de tristesse et d'envie (sentiment que j'avais moi-même déjà maintes
fois éprouvé !).
Nous prenons le train à Sagan et arrivons de nuit à Mühlberg, en Saxe. Trajet très pénible dans la neige pour
gagner le stalag local, à quelques kilomètres. J'ai toutes les peines du monde à porter ou tramer ma lourde
caisse de bois qui contient mes affaires et mes précieuses notes.
Nous trouvons au camp d'autres libérables, notamment d'autres compiégnois (nous sommes 6 ou 7 compatriotes) et
le contingent total du convoi est de 400 hommes environ. Séjour bien long et décevant de trois semaines, dans
l'attente du départ (lectures, conférences, chapelle, théâtre).
Finalement, nous partons vers le 25 Janvier et entreprenons un voyage de trois jours à travers toute l'Allemagne
(Weimar, Gotha) dans des wagons de marchandises. Longs stationnements sur des voies de garage, barbotage de
briquettes pour alimenter les poêles de nos wagons, mais accueil aimable dans les cantines des gares, où nous
sommes servis par des dames de la Croix-Rouge allemande.
Enfin, arrivée à Trèves, d'où nous gravissons la colline de Pétrisberg, pour accéder au camp de rapatriement,
où nous devions séjourner environ une semaine. J'y fis la connaissance de Legendre, futur député de l'Oise et
maire de Compiègne, qui y était employé dans les bureaux. Je suis sollicité de rédiger ce fameux article qui
devait avoir un tel retentissement !...
Et puis, un beau matin, c'est le rassemblement final pour le grand retour. Il fait un temps splendide et le
moral est au plus haut. Je suis désigné comme chef de convoi avec un aspirant et on nous réserve dans le
"Zug", un luxueux compartiment capitonné de velours vert.
Nous rentrons en France, via Longwy, Reims, Laon. Partout, accueil inoubliable des autorités locales. De Reims,
je fais téléphoner à Ginette mon imminente arrivée, en l'invitant à m'attendre sagement à la maison.
Le 6 février, vers 18 heures, nous atteignons la forêt de Compiègne. Je suis oppressé et des larmes me montent
aux yeux. Le Sonderführer, qui voyageait dans mon compartiment, se rend compte de mon émotion et m'adresse
quelques paroles qui me touchent.
Compiègne !... Je saute du train, dans les bras de Marigny, Madame Defrance, Madame Martain. Nous nous
étreignons, un photographe fixe la scène. Chaleureux accueil du maire (Lhuillier), du sous-préfet (Gasné) et
des habitants. Le Sonderführer me complimente et ne dit : "Monsieur le Notaire, est-ce là votre famille ?".
Bref séjour au Quartier du Cours Guynemer, où, piloté par les capitaines de Soultrait et Raveau, je franchis
dans un temps record les nombreuses étapes de la libération (douche, coiffeur, visite médicale, perception de
la solde, de vêtements civils, change de Lagermarks, démobilisation). Je me retrouve vers 9 heures du soir sur
la place de l'Hôtel de Ville. Je suis frappé de l'étendue des ravages de la guerre dans la pauvre cité et de
l'aspect des ruines de la place du Change, au clair de lune.
A 9 heures 1/2, je tombe dans les bras des miens... Ginette inchangée, Jean-Claude un petit homme, Nicole
méconnaissable !... Dîner spécialement soigné, en dépit des difficultés alimentaires, et la nuit entière se
passe à bavarder à bâtons rompus. Nous avons tant à nous dire !...
Les jours qui suivent sont consacrés à l'audition d'une messe dite pour les rapatriés, aux visites de
remerciement aux autorités, à une démarche à Laon pour les formalités ultimes de la libération (bien que je ne
sois qu'en congé de captivité et que je sois astreint à un pointage périodique de ma carte à la Feldgendarmerie)
, à un court séjour à Paris où j'ai la joie de retrouver toute ma famille, mon Père cependant bien changé, à
de multiples visites d'amis et de clients.
Et puis, la vie civile reprend son cours...